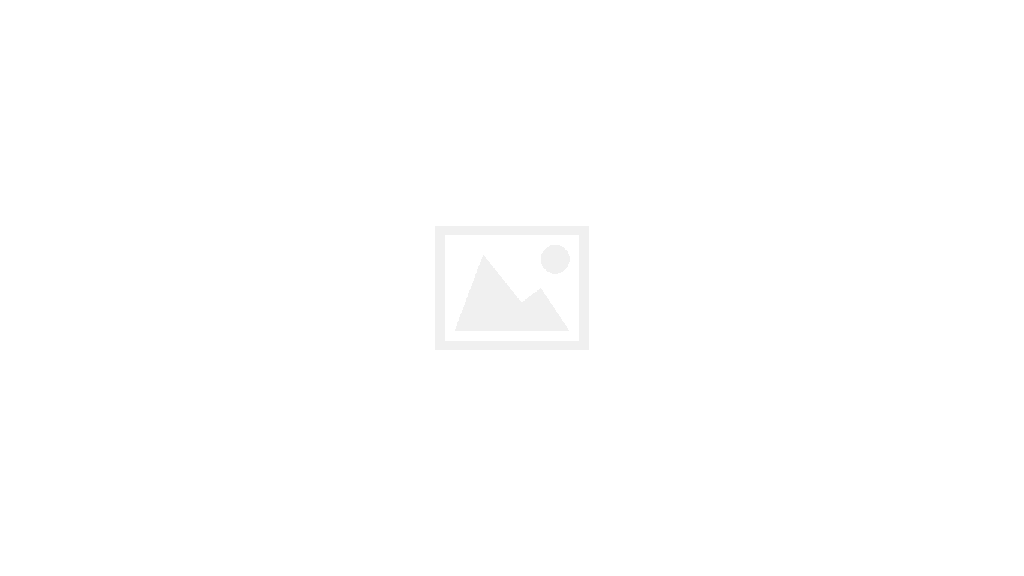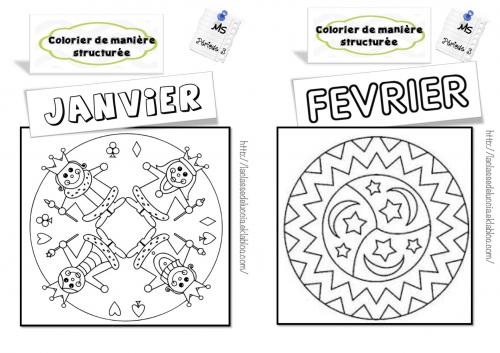L’histoire tient lieu de l’homme
Les Œuvres de miséricorde de Mathieu Riboulet (Verdier, 2012) pose la question de notre rapport avec un passé terni par la violence humaine, plus exactement celui qu’entretiennent les peuples français et allemands d’aujourd’hui avec les trois « faits massifs » de leur histoire moderne, qui ont respectivement pour dates 1870, 1914 et 1939 et « dont aucun déni ne fera qu’ils n’aient jamais eu lieu », peut-on aisément affirmer avec l’auteur. Le roman illustre une forme d’empêtrement universel, pour reprendre un terme de Wilhelm Schapp, dans lequel le tissu temporel s’amenuise, un empêtrement agi par l’histoire judéo-chrétienne dans lequel se logent d’autres histoires attribuables à des parcours individuels, eux-mêmes tramés de mémoire, de blessures et de conjonctions diverses. En se basant sur les commandements moraux édictés par l’Église par l’entremise de la parole de Matthieu1, le narrateur, un Français investi par une sorte de « volontarisme historique » décide d’aller à la rencontre de l’homme allemand, à Cologne puis à Berlin, pour tenter de comprendre ce qui le rattache à une histoire englobante traversée d’ellipses :
J’ai pris, en commençant, sur mes épaules le poids de la langue, de l’histoire, du pays et du temps où je suis arrivé. Il n’y avait, chez les miens, aucun ressentiment vis-à-vis des hommes et des femmes qui, comme eux, mais outre-Rhin, avaient englouti des forces déraisonnables dans des conflits dont on m’apprit très tôt qu’ils ne naissaient pas tant d’une prétendue haine des uns pour les autres que de la mise en jeu de mécanismes ressortissants à la politique, l’économie, la religion ou la géographie. Mais il y avait, mêlée à l’indécis flottement dont sont tissées nos vies, une trame parfois lâche ou trouée, parfois serrée à étouffer, l’Histoire, à laquelle on collait un grand H, et sur cette trame trois faits, enchâssés les uns dans les autres en une seule et même cadence historique dont chaque mouvement générait les conditions d’éclosion du suivant […].
Il comprend de la sorte que ce n’est que par le détour des histoires singulières du corps étranger, son voisin qui fut aussi par relation de contigüité historique son rival – il choisira d’abord le corps d’Andreas, figure du bourreau -, qu’il lui faudra toucher, caresser, pénétrer jusqu’aux entrailles (au sens propre comme au sens figuré), qu’il aura peut-être accès à cette histoire englobante qui le hante, qu’il ressent comme une (pré)disposition à la fois organique et abstraite :
Car c’est finalement toujours nous qui portons les abîmes de l’Histoire, tapis dans nos organes, qu’il faut aller chercher pour danser avec eux dans le silence des gestes. Alors l’Allemand et moi avons repris en main nos nuques respectives et plongé l’un dans l’autre, sans un bruit et sans haine.
Dans cette danse érotique et macabre avec l’Allemand dont témoignent des pages au Verbe sublime, dans cet acte entre l’étreinte et le calvaire il y a, motivée par les regrets, cette recherche ultime des moyens qui permettraient de signer un accord de paix absolu, d’apaiser les douleurs héritées de part et d’autre :
Si je pouvais tout entier t’absorber dans un désir dément de gagner ton essence et ta vitalité, ficher dans mes entrailles cette magnificence sans âge et sans destin, j’aurais sans doute gagné, et l’Histoire avec moi, un peu de cette paix si douce à nos épaules quand nous la rencontrons.
Ainsi le corps de peinture d’Andreas grâce auquel la pensée bascule, un « corps de toujours, venu des très vieux temps », comme une porte d’accès à l’homme, à l’être humain et à ses histoires, à son devenir (si par exemple venait ce jour du Jugement dernier…) :
[…] si j’ai choisi Andreas pour m’aider à comprendre quelque chose aux strates d’histoire qui s’accumulent en moi, à ce qui traverse le pinceau de Caravage, à ce qui se joue dans l’âme quand les corps se rejoignent, il vaut mieux que nous fassions ensemble un tout petit peu plus que de tirer un coup. Et mieux il m’aidera dans cette réflexion, mieux je l’aiderai à avancer de son côté, quelle que soit la fin qu’il poursuivra avec moi, dont évidemment j’ignore tout.
Dans le livre de Mathieu Riboulet prend place, plus que l’ordre des choses et la finalité qu’il pourrait commander, un rets de questions, et non les moindres, puisque ce sont celles que poserait un ensemble de dilemmes moraux à nos consciences si à l’image du narrateur on prenait le risque, contrairement à Orphée, de se retourner pour évaluer le chemin parcouru :
Qu’y a-t-il dans le corps de l’autre que je veuille posséder avec tant d’ardeur dans le combat, dont je veuille vérifier la présence avec tant de précision dans le Livre ? Qu’as-tu en toi d’enchanteur à ce point, Andreas ? Qu’aviez-vous sous la peau, corps allemands, dont nous ayons voulu par trois fois vous priver, qu’avions-nous sous les côtes, corps français, que vous ayez voulu par trois fois nous soustraire ? Qu’avait donc le corps juif qu’il ait fallu ôter, et pour cela fouailler, émonder, équarrir, en nous couvrant de sang, puis de suie, puis de cendres ? L’infini du désir, et pour y accéder l’infini de nos corps ; l’infini des pensées, et pour le traverser l’infini de nos joies ; et l’infini du Livre, enfin, que rien n’arrête, pas même le doigt des saints, l’élan de la Passion et la fureur du meurtre.
À Adrien, dont la chair porte les stigmates d’autres violences qui se sont passées en d’autres zones, il dira dans ce même esprit tourné vers la recherche de la connaissance (qui doit aussi, on l’aura compris, inclure les doutes dans la relation franche avec l’autre sans quoi il serait inutile de préserver le lien) :
Regarde cette paume et dis-moi si je peux la poser sur ton dos, regarde cette main et dis-moi si je peux la poser sur ta tête ou y serrer la tienne pour le salut du jour sans que tu penses aux coups, au sexe ou à la mort – que je porte avec moi mais pour d’autres usages où tu n’entreras pas ? Le temps et les pères passent, c’est notre seul chemin, prenons-le sans trembler ou ne viens plus ici que quand je serai loin.
De tout temps le lieu de l’art
« Quel lieu assigner à ce qui se refuse à la pensée humaine ? »
Dans ces Œuvres de miséricorde comme dans une longue tradition de la pensée, l’art a valeur de transfiguration, il est ce « qui unifie le temps, les peines et les joies et continue longtemps à nous transfigurer ». C’est à travers Rome, où sont exposées les plus grandes toiles de Caravage, figure majeure du naturalisme italien dont un des tableaux fait écho au titre de cet ouvrage et en partage le récit fondateur, que cette conviction s’exprime avec le plus de clarté. Sans doute parce qu’avec l’Italie, le narrateur affirme n’avoir aucun compte historique à solder. « J’ai […], dit-il par ailleurs à propos du pays, toujours eu l’impression que la littérature et le cinéma italiens de la seconde moitié du siècle dernier avaient très courageusement pris en charge une réflexion collective multiforme sur l’histoire, allégeant par là même singulièrement notre travail [je souligne] ». Ainsi l’ombre de Pasolini, qui donne entre autres exemples ses couleurs de tragédie à la fin du roman. Mais l’art, c’est aussi celui du récit.
Dans ce texte, il n’est pas tant question de devoir, un terme qui, on le sait, est lourdement connoté parce qu’imputable à une morale que le narrateur prend soin de mettre à distance2 que de « travail », travail de mémoire et d’oubli (incluant le pardon selon la thématique chrétienne) que nous intime notre condition historique des humains que nous sommes, pour reprendre une formule de Paul Ricœur dans un ouvrage important3.
C’est ainsi que, les épaules chargées du poids de l’histoire, l’écrivain entreprend une réflexion sur l’héritage des guerres qui ont marqué l’Europe et son enfance de façon indirecte, avec ses trois grandes fractures modernes qui occupèrent les devants de la scène littéraire du siècle dernier, mais qui le seront sans doute de moins en moins, laissant progressivement le raisonnement sur cette tranche du passé céder le pas, on peut en faire l’hypothèse, à une simple mobilisation de références à visée contextuelle (un fond historique dans lequel s’ancre à divers degrés tout récit) au sein d’autres fictions dont les ressorts et par conséquent le propos éclaireront des préoccupations plus récentes. Le discours essayistique présent dans le roman, non par hasard sous-titré fictions & réalités, est sans nul doute ce qui contribue (en plus du style) à conférer à l’ouvrage sa profondeur et son originalité dans le bassin général des productions romanesques actuelles.
Ici, c’est bien dans les mailles de la narration en clair-obscur de Mathieu Riboulet que se dépose l’histoire, toute tissée d’allusions artistiques comme autant de signes à déchiffrer, comme autant de strates à ajouter à l’histoire première. L’écriture joue ce rôle de l’axe autour duquel pivote et s’affirme l’opération historiographique à laquelle l’auteur s’adonne, dans un acte de foi qui échappe à toute forme de réécriture des événements, à travers « initiatives touristiques » et corps à corps « à présent » – scènes que l’on scelle par la jouissance ou la violence (rejouant le jeu d’Éros et Thanatos, ce couple mythique qui était déjà au cœur des livres précédents de Riboulet), si bien qu’une véritable communion avec les amants étrangers qui portent en eux qui la figure du bourreau qui la figure de la victime a lieu. Puisque, de surcroit, cet art de la rédemption, pour filer la métaphore chrétienne, trouve son plein dynamisme dans ces rencontres primitives avec ce qui fut jadis un ennemi ; puisque ces combats des corps, soumettant la matière historique à une forme de pensée sauvage ouvre sur ce temps d’aimer et ce temps de mourir qu’illustre à sa façon le film de Douglas Sirk revu par le narrateur avant son départ pour Berlin.
Si pour un Pierre Michon, pour ne nommer que cet auteur contemporain auquel je pense à la lecture du livre, ce sont tantôt des figures d’écrivains qui sont la « littérature en personne » (Rimbaud le fils, Trois auteurs, Corps du roi4…), pour Mathieu Riboulet, ce sont surtout les hommes du présent pétris par l’Histoire qui sont la Littérature, en ce sens qu’ils donnent forme à sa littérature, que l’on inclura volontiers dans la nôtre, parce qu’elle est aussi formes de vie et d’action, empêtrement entre des forces vives – ces œuvres de miséricorde comme une porte d’accès possible à une conscience individuelle, sous-tendue qu’elle est par un héritage brisé dans le temps et qui en déborde noblement, et avec une beauté rare, ses frontières poreuses. Bouger ses « bornes symboliques, émotionnelles » à qui du moins en « éprouve le besoin » : mettre le doigt sur ces corps, dans le récit, à veiller comme un saint sacrement :
Sous ses dehors aimables, industrieux et parfois mornes, l’Allemagne m’en semble recouverte [de cicatrices] dont je ne peux savoir comment elles sont senties par ceux-là qui la peuplent, sinon par l’art qui ça et là nous jette, aux sens, aux yeux, de ces poignées de terre noircie qui est la terre des ruines, la terre des incendies, de la déréliction, ce qui reste au retour de la paix du meurtre commis par les pères. Le fait nazi, cette masse impensable dont l’ombre projetée persiste à s’étendre sur l’histoire du monde, à laquelle mon regard français ajoute les ramifications dues à l’Occupation, n’est pas un empêchement à aimer ce pays, ceux qui le peuplent et y travaillent, mais il demeure5 – non au sens de la persistance idéologique ou du renouvellement factuel, au sens de l’être-là, de la maison, de la trace ineffable : celle du sang sur la clé de la porte que le peuple, un jour, a poussée, entrouverte un instant pour qu’on y voie l’enfer, et qu’un atroce déluge de bombes a péniblement refermée, laissant les hommes hagards et l’incendie œuvrer. Tes lèvres, Andreas, et tes os, tes gestes mesurés, le creux de tes reins doux, ta queue chaude, ton sourire, cette source de toi à laquelle je m’abreuve, à Berlin que l’Histoire réduisit à néant, où je me sens si avisé d’être venu toucher, du doigt, la blessure profonde marquée au flanc de l’homme.
Texte © Annie Rioux – Photos © DR – Illustrant le texte : Les Sept Œuvres de la miséricorde, Le Caravage, 1607, Huile sur toile (390 cm x 260 cm), conservé au Pio Monte della Misericordia à Naples.
Pour lire les autres textes publiés sur D-Fiction du workshop “Fermé le Jour-Ouvert la Nuit”, c’est ici.
ANNIE RIOUX a collaboré à divers périodiques, a enseigné le français à l’étranger, a travaillé dans le milieu des arts visuels.
- Donner à manger à ceux qui ont faim. Donner à boire à ceux qui ont soif. Vêtir ceux qui sont nus. Loger les pèlerins. Visiter les malades. Visiter les prisonniers. Ensevelir les morts.
- « Je ne prétends pas donner de leçon de morale a posteriori, soutient le narrateur, ni me livrer à des transgressions de pacotille simples à envisager une fois le danger passé. Je cherche simplement à comprendre comment le Corps Allemand, majuscule à l’appui, est entré dans la vie française et continue à en façonner certains aspects […] ».
- Dans la lignée des sociétés chrétiennes, sur laquelle prend appui le livre de Riboulet, la question du salut est ce qui donne un sens à l’histoire. Comment les commandements moraux de l’Évangile de Matthieu (25, 34-40), qui ont pu traverser les siècles et façonner des générations, « qu’ils le veuillent ou non » (voir la préface), et dont nous sommes encore imprégnés pour la plupart, ont pu cohabiter avec la violence inouïe dont est capable de faire preuve l’humanité ? Comment tirer de la connaissance de ce regard que l’on pose après coup sur ces documents, littérature religieuse, et sur les faits du passé ? Voilà l’interrogation principale qui étaye ce roman.
- Comment, en effet, ne pas sourire, comme à la visite impromptue d’un vieil ami, en voyant « apparaître » dans le texte ce noli me tangere lourd de sens dont Michon affublait le visage de Beckett dans son « Les deux corps du roi », récit qui prend lui-même son inspiration d’une source ancienne de l’histoire politique élisabéthaine notamment mise en lumière par Ernst Kantorowicz ?
- En italique dans le texte.